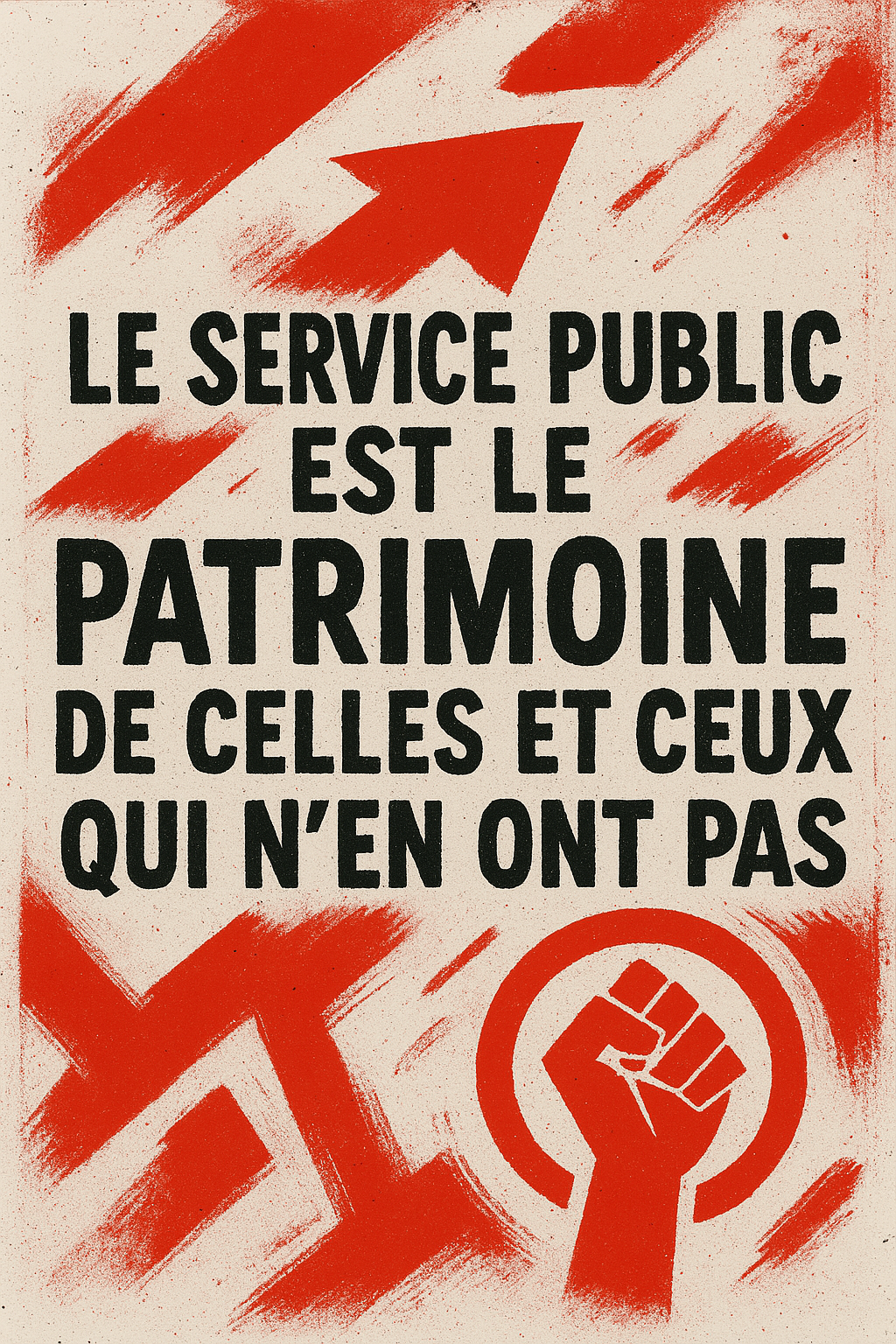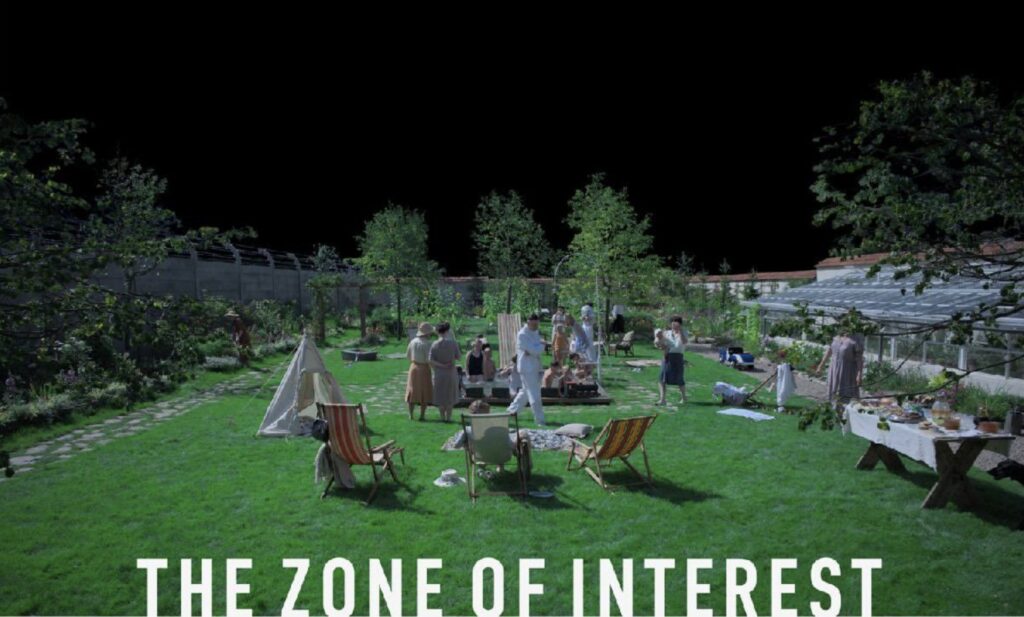Après plus de cinq siècles d’occupation ottomane, l’Albanie proclame son indépendance le 28 novembre 1912. Ce moment historique survient dans un contexte tendu, alors que le territoire albanais est assiégé par les troupes serbes et monténégrines au nord, et les forces grecques au sud. Cette déclaration marque une étape cruciale de la lutte anticoloniale albanaise, qui se poursuivra par ailleurs au Kosovo sous le joug serbe.
Le nationalisme albanais n’est pas un nationalisme impérialiste, mais un nationalisme de résistance et de lutte anticoloniale face aux grandes puissances impérialistes européennes et slaves, qui s’affronteront par ailleurs pendant la Première Guerre mondiale.
L’indépendance survient à un moment crucial, alors que le pays traverse une Renaissance culturelle sans précédent. Cette période est marquée par une prise de conscience identitaire qui transcende les appartenances religieuses. L’unité nationale repose avant tout sur la langue : parler albanais, c’est être albanais. Peu importe les origines ou le sang, la langue devient le socle de cette identité partagée, fédérant une nation dans sa diversité.
Le monde ne sera sauvé, s’il peut l’être, que par des insoumis. Sans eux, c’en est fait de notre civilisation, de notre culture, de ce que nous aimions et qui donnait à notre présence sur terre une justification secrète.
THE ZONE OF INTEREST, À VOIR ABSOLUMENT AU CINÉMA !
Il y a une semaine, je suis allé voir « The Zone of Interest » de Jonathan Glazer. Ce film m’a profondément marqué et je ressens le besoin ici de partager mon avis à son sujet.
Dans ce long-métrage, nous sommes plongés dans l’Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale, suivant la famille de Rudolf Höss, le commandant du camp de concentration d’Auschwitz. Höss vit dans une maison juste à côté du camp, ce qui crée un contraste frappant entre sa vie de famille en apparence ordinaire et les atrocités qui se déroulent à quelques pas de chez lui.
Bien que « The Zone of Interest » traite de l’Holocauste, il aborde, selon moi, des thématiques contemporaines telles que l’aliénation et la banalité du mal, inspirées des travaux d’Hannah Arendt. Le film met en lumière comment l’aliénation peut conduire à la complaisance face au crime et à l’injustice, avec des personnages qui se cachent derrière l’excuse de simplement « faire leur travail ».
Selon moi, le réalisateur, Jonathan Glazer, nous confronte à la réalité de notre époque en établissant des parallèles entre les horreurs de l’Holocauste et les injustices modernes de la société capitaliste. En particulier, l’aliénation dans le monde du travail qui conduit à l’acceptation tacite de pratiques injustes et criminelles, telles que l’exploitation des ressources naturelles et la spéculation sur les matières premières, appauvrissant ainsi les peuples et les populations locales au profit des grandes multinationales.
Comment les cadres des multinationales justifieraient leurs actions aujourd’hui ? « Je ne fais qu’obéir aux ordres », diraient-ils, ou encore : « J’aspire à faire vivre et rendre ma famille heureuse. » Comme Rodulf Höss en somme, qui déclara en effet lors du procès de Nuremberg qu’il ne faisait qu’obéir aux ordres.
Il y aurait encore beaucoup à dire et à développer mais en résumé, « The Zone of Interest » nous invite à réfléchir aux conséquences de l’aliénation et de la complaisance face aux crimes et aux injustices auxquels nous sommes confrontés aujourd’hui, je pense notamment aux récents événements à Gaza. Le film nous pousse à remettre en question notre propre complaisance face à l’injustice et à nous interroger sur notre responsabilité dans la lutte contre ces atrocités.